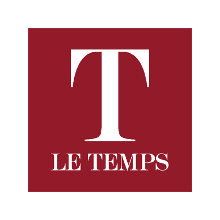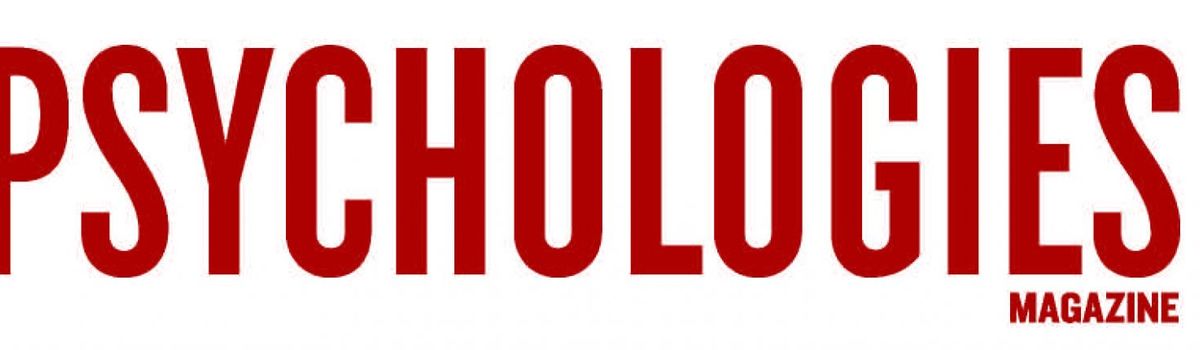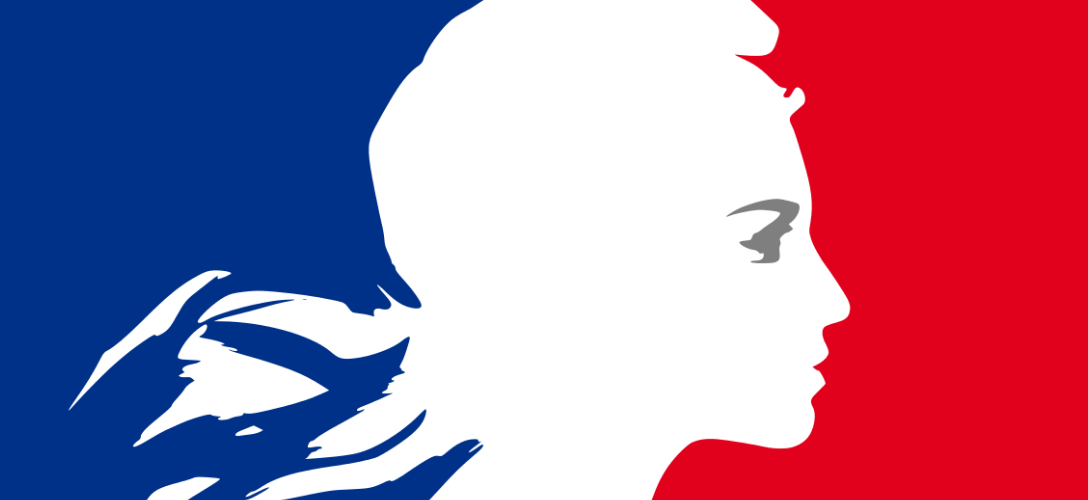Mon Psy ne me croit pas (ou le diagnostic différentiel)
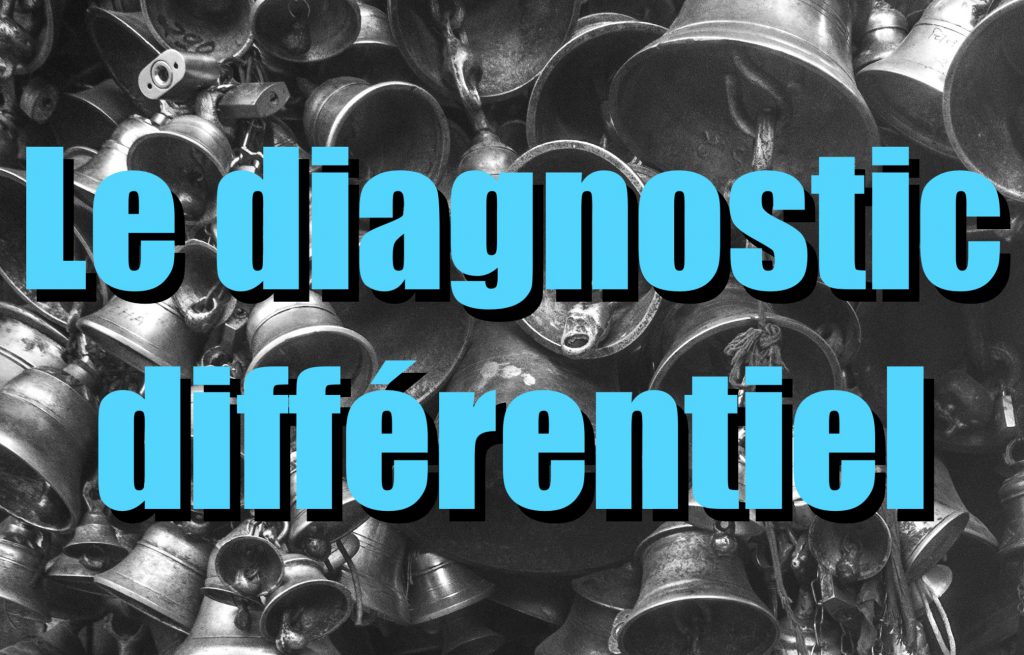
Vous est-il déjà arrivé de penser que votre psy ne vous croyait pas ? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre psy pouvait montrer un désaccord avec vous ? Ou si vous n’avez encore jamais consulté, vous posez-vous la question : « Est-ce que ce psy ira bien dans mon sens ? » Et bien sachez une chose, […]
La réalité psychique

Certainement LE concept le plus fondamental quand on est psychologue ou psychothérapeute ! Beaucoup l’oublie mais ce n’est pas dans les livres que se trouvent la réalité de nos patients mais bel et bien dans leur discours. La vision que l’on a en tant que professionnel peut parfois nous faire oublier que nous avons tous […]
Normal ou pathologique ?
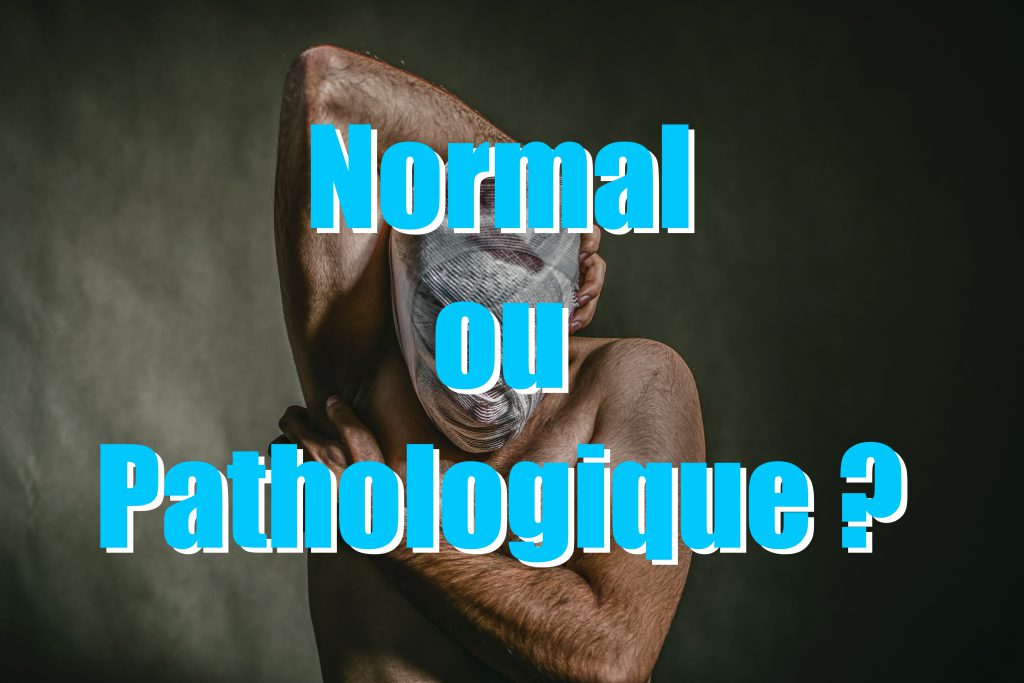
Au delà du fait que la question du normal et du pathologique se pose chez tout le monde, c’est aussi une question qui est extrêmement difficile et peine à faire consensus chez les professionnels. Pour certaines personnes, ne pas faire comme tout le monde n’est pas normal, pour d’autres, tout est toujours normal, nous sommes […]
Peut-on coucher avec son/sa psy ?

En voilà une question… importante. Même si ce blog concerne des consultations à distance, je travaille également en présentiel dans mon cabinet et il est assez fréquent que dans les diverses curiosités que les gens ont envers notre métier de psychologue, le fantasme du psy qui couche avec ses patientes se manifeste. Comme je le […]
Qu’est-ce que la Pulsion et à quoi ça sert ?
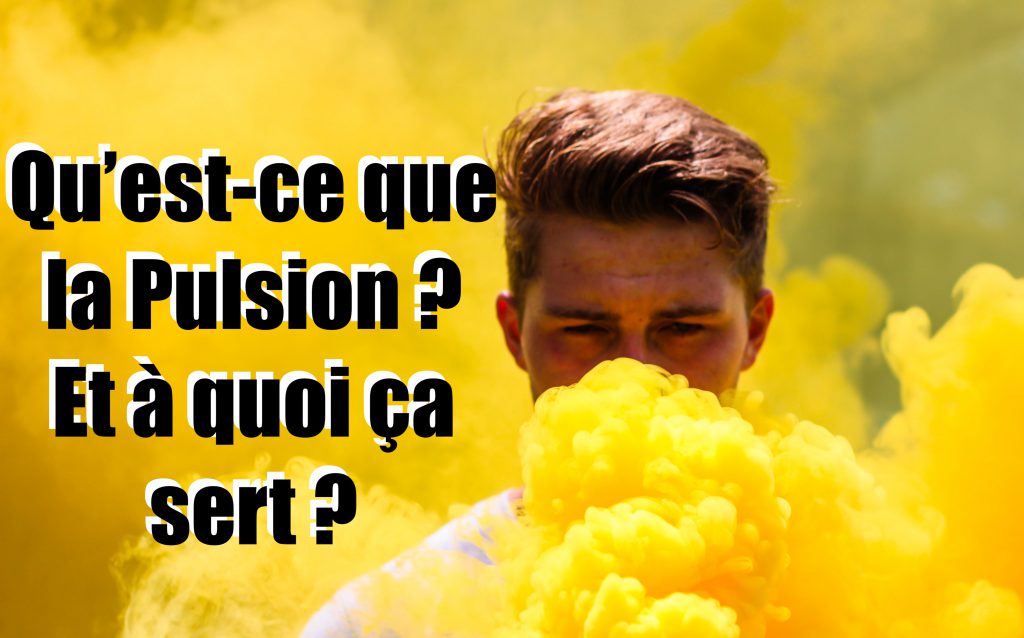
Je vais ici succinctement parler de la pulsion, un concept qui a été largement dépassé (notamment par le concept de désir de Lacan) depuis sa théorisation par Freud mais qui est tout de même très utile aujourd’hui encore pour se repérer avec ses patients en séance.
Pourquoi doit-on payer son psy ?

En quoi est-ce que l’acte de payer un psychologue, un psychothérapeute ou un psychanalyste porte un sens particulier ?
La seconde topique (l’Inconscient freudien partie 2)

Si vous n’avez pas lu le premier article sur l’Inconscient freudien, je vous renvoi vers cette première lecture en cliquant ICI.
L’inconscient freudien, qu’est-ce que c’est ?
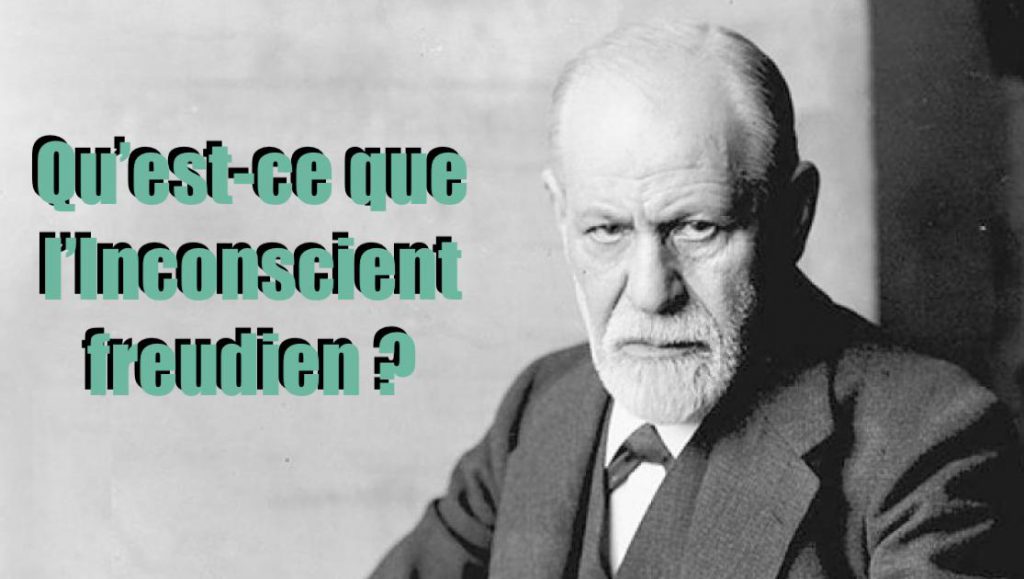
L’Inconscient comme savoir… Dans ce premier article, vous verrez ma toute première vidéo qui date (déjà) de Juin 2015… À cette époque, vous verrez que je ne maîtrisais pas encore la vidéo (ni le son) comme aujourd’hui, mais j’assume mon passé qui fait pleinement partie de moi 😉 Bonne lecture et bon visionnage !