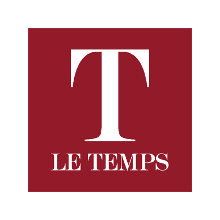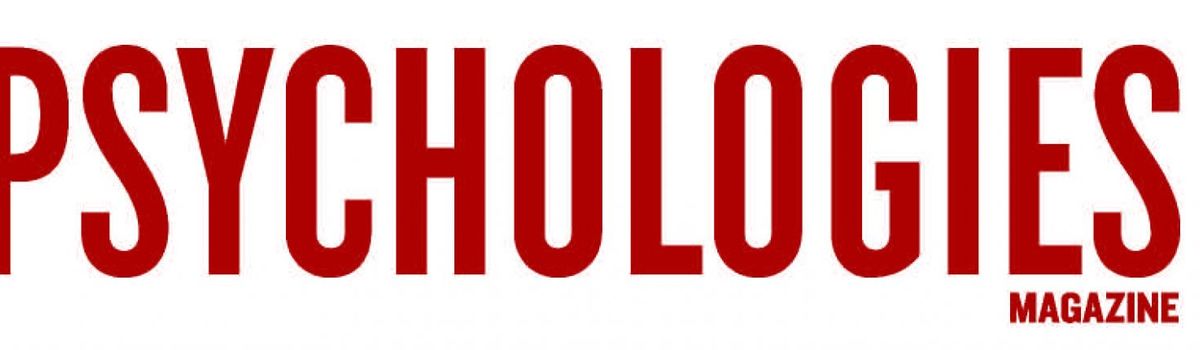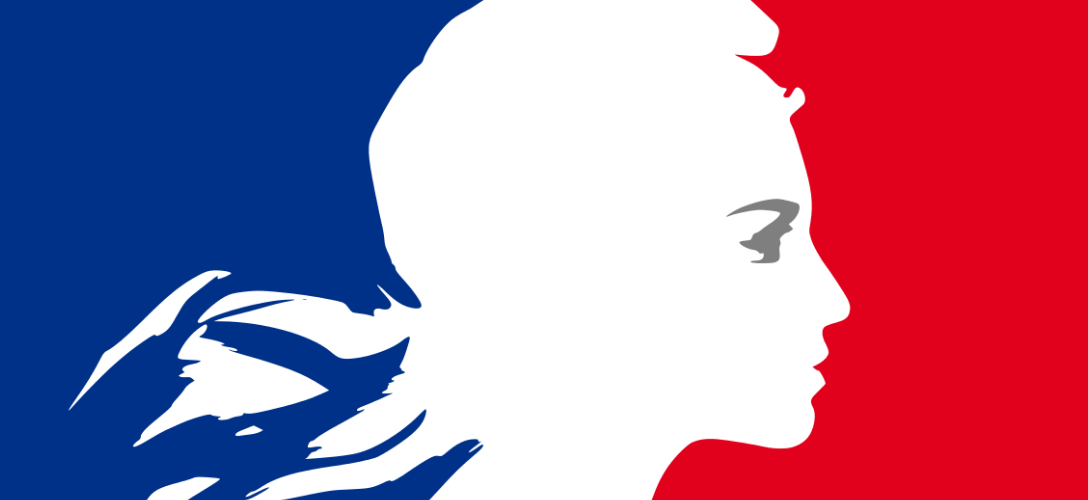Manipulation des Émotions : Comment Elles Influencent Nos Pensées et Nos Actions ?
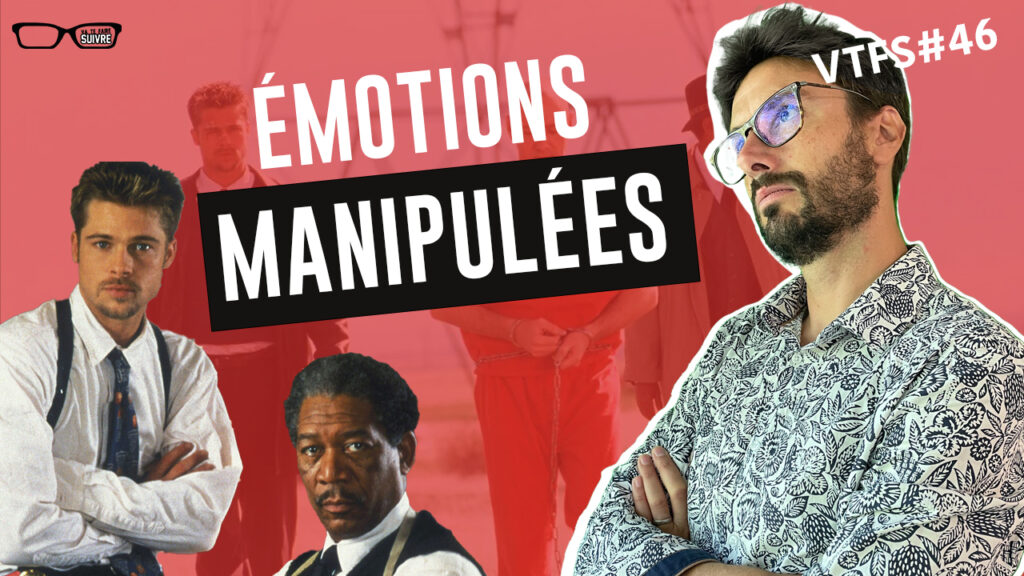
Dans notre société actuelle, les émotions sont devenues un véritable produit de consommation. Que ce soit à travers la musique, la lecture, l’image, l’information ou l’expérience de vie, l’être humain est attiré par tout ce qui peut lui procurer une émotion. Les émotions stimulent et influencent nos comportements de manière impressionnante. Les Émotions, Vecteurs d’Histoires […]
L’interprétation en thérapie

Après une définition de ce qu’est l’interprétation en psychothérapie, nous allons voir si elle est propre à la psychologie, comment et sur quoi s’appuie une interprétation fiable et pertinente et surtout a-t-elle une valeur thérapeutique pour les patients ? Tout au long de ce questionnement, je vais illustrer chaque point grâce au film Watchmen de […]
L’Hypnose thérapeutique

J’insiste d’ores et déjà sur le « thérapeutique » dans le titre de cet article puisque cela n’a strictement rien à voir avec l’hypnose de spectacle à la Mesmer… donc non, un thérapeute certifié ne vous fera jamais faire la poule pour vous ridiculiser en public. Dans cet écrit, nous allons tout d’abord définir ce qu’est l’hypnose, […]
Conseils en temps de confinement
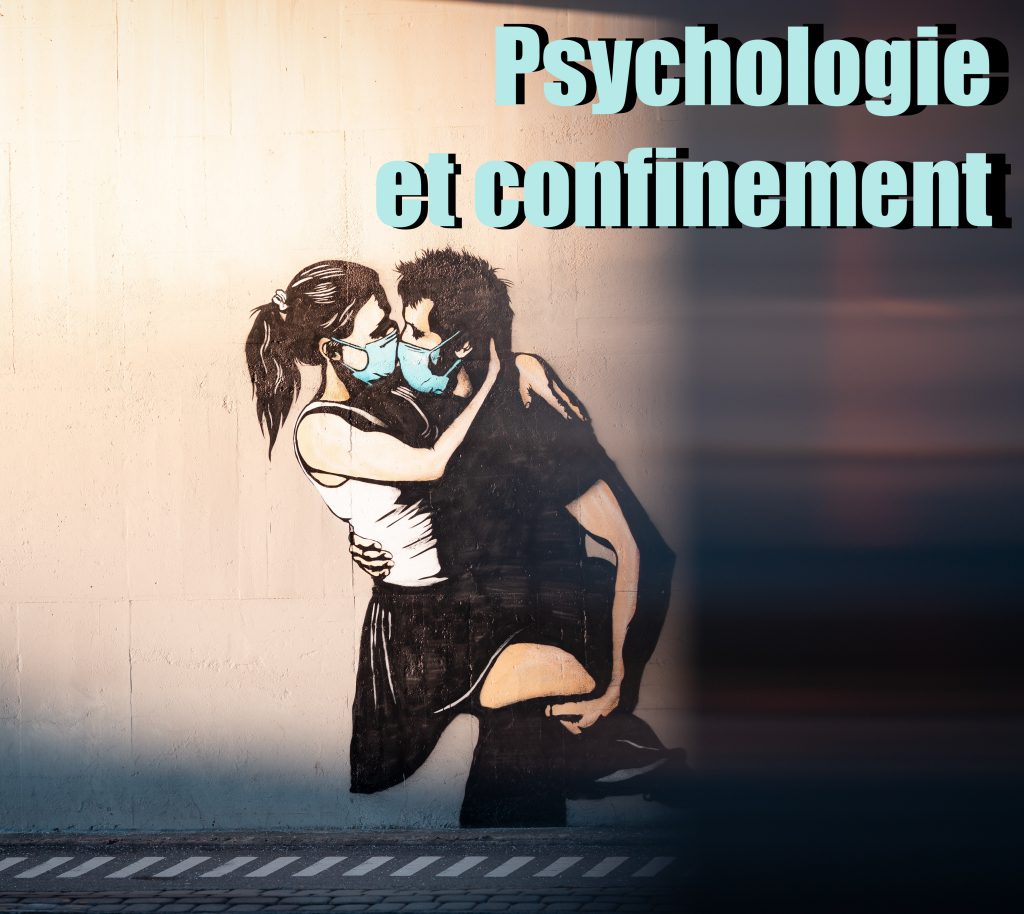
Photo : Daniel Tafjord Je vais ici tâcher de répondre à ce qui relève de mon domaine de psychologue clinicien en ce qui concerne les mesures non explicites de confinement qui ont court aujourd’hui en France pour cause d’épidémie (si ce n’est de pandémie) du coronavirus ou COVID-19. Quelles sont les conséquences psychologiques d’un tel enfermement […]
En quoi le concept de castration est pertinent ?
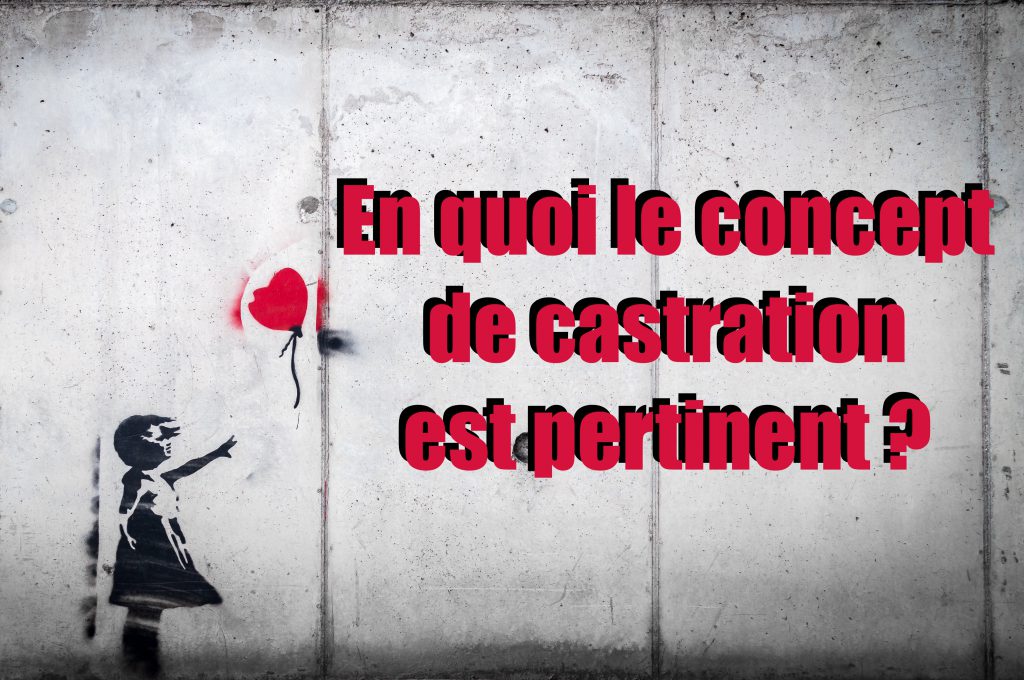
Pour ce qui est de comprendre ce qu’est le concept de castration dans les grandes lignes, de comprendre globalement ce qu’il signifie dans la pensée freudienne et lacanienne, je vous invite à regarder la vidéo que j’ai faite en collaboration avec Kevin de La Psychothèque autour du film « Edward aux mains d’argent » : Maintenant que vous […]
Mon Psy ne me croit pas (ou le diagnostic différentiel)
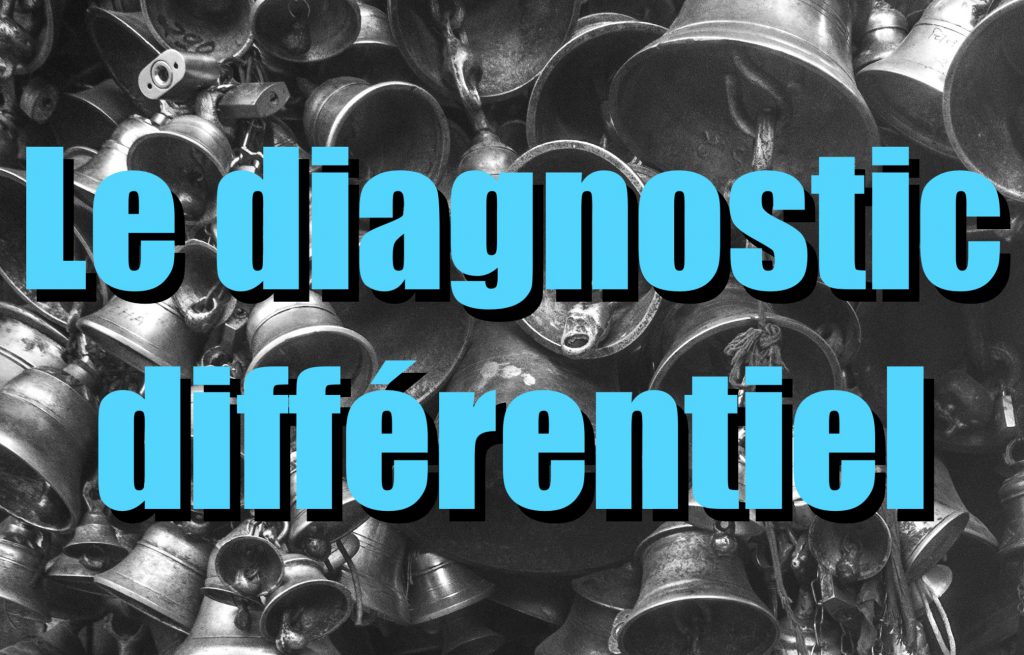
Vous est-il déjà arrivé de penser que votre psy ne vous croyait pas ? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre psy pouvait montrer un désaccord avec vous ? Ou si vous n’avez encore jamais consulté, vous posez-vous la question : « Est-ce que ce psy ira bien dans mon sens ? » Et bien sachez une chose, […]
La réalité psychique

Certainement LE concept le plus fondamental quand on est psychologue ou psychothérapeute ! Beaucoup l’oublie mais ce n’est pas dans les livres que se trouvent la réalité de nos patients mais bel et bien dans leur discours. La vision que l’on a en tant que professionnel peut parfois nous faire oublier que nous avons tous […]
Peut-on coucher avec son/sa psy ?

En voilà une question… importante. Même si ce blog concerne des consultations à distance, je travaille également en présentiel dans mon cabinet et il est assez fréquent que dans les diverses curiosités que les gens ont envers notre métier de psychologue, le fantasme du psy qui couche avec ses patientes se manifeste. Comme je le […]
Pourquoi doit-on payer son psy ?

En quoi est-ce que l’acte de payer un psychologue, un psychothérapeute ou un psychanalyste porte un sens particulier ?