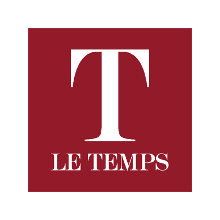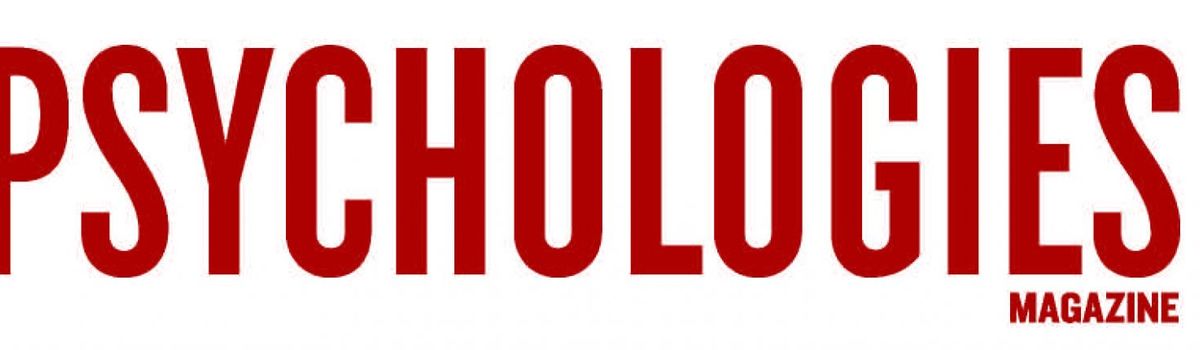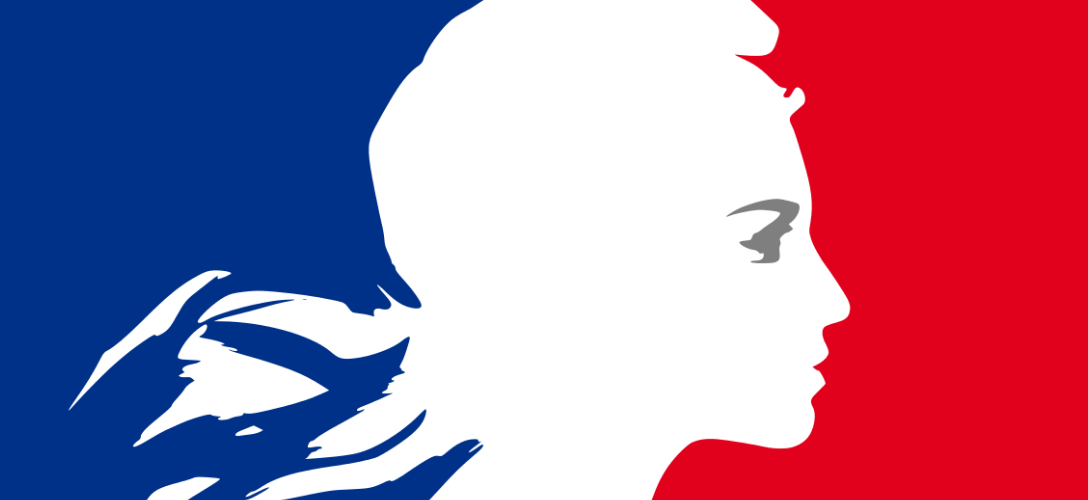Comment devient-on fou ?
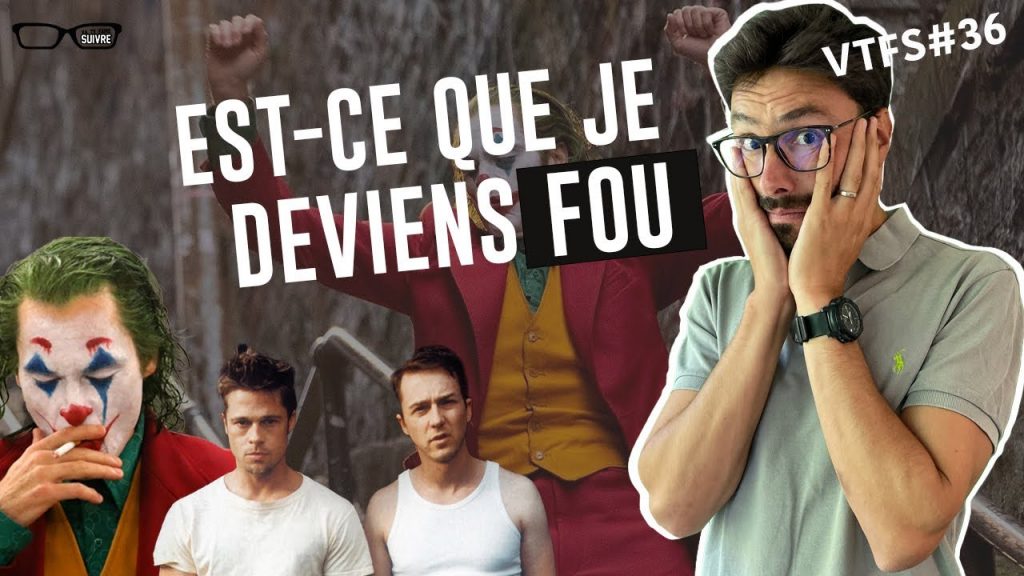
Le normal et le pathologique La notion de « folie » est complexe et peut être interprétée de différentes manières selon les cultures, les époques et les sociétés. En psychiatrie, on parle souvent de « troubles mentaux » plutôt que de folie. Mais la limite entre normal et pathologique est si floue que depuis les travaux de Georges Canguilhem, […]
L’interprétation en thérapie

Après une définition de ce qu’est l’interprétation en psychothérapie, nous allons voir si elle est propre à la psychologie, comment et sur quoi s’appuie une interprétation fiable et pertinente et surtout a-t-elle une valeur thérapeutique pour les patients ? Tout au long de ce questionnement, je vais illustrer chaque point grâce au film Watchmen de […]
L’insatisfaction perpétuelle chez Tony Montana
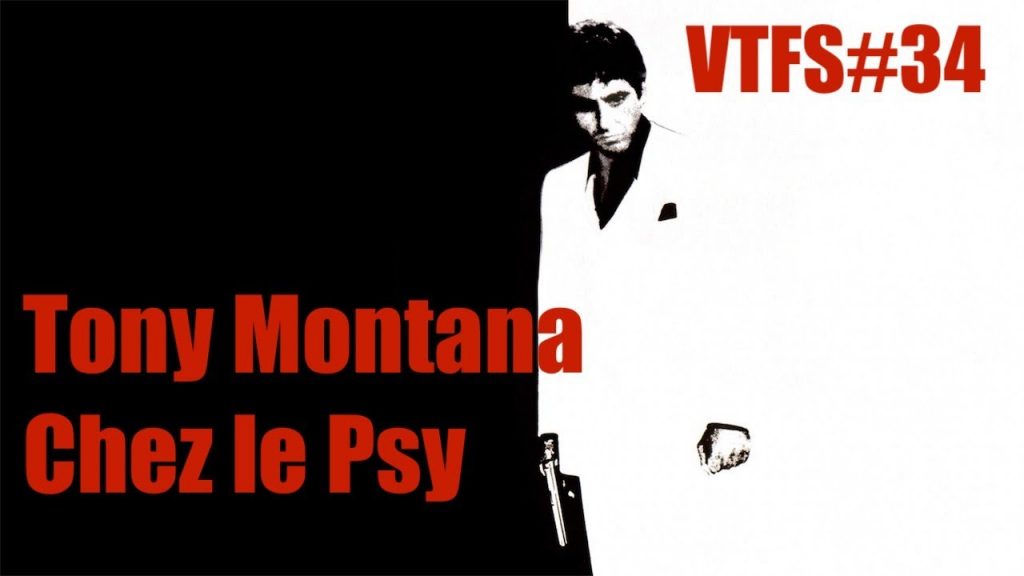
L’insatisfaction perpétuelle… Oui, vous pouvez vous dire que ce n’est pas un sujet de psychologie… Mais laissez-moi vous montrer comment Scarface, le film culte de DePalma nous apprends de grands fondamentaux de psychologie. Il nous faut dès à présent poser le contexte pour que vous compreniez en quoi ce film est culte alors que le […]
Les Pervers Narcissiques
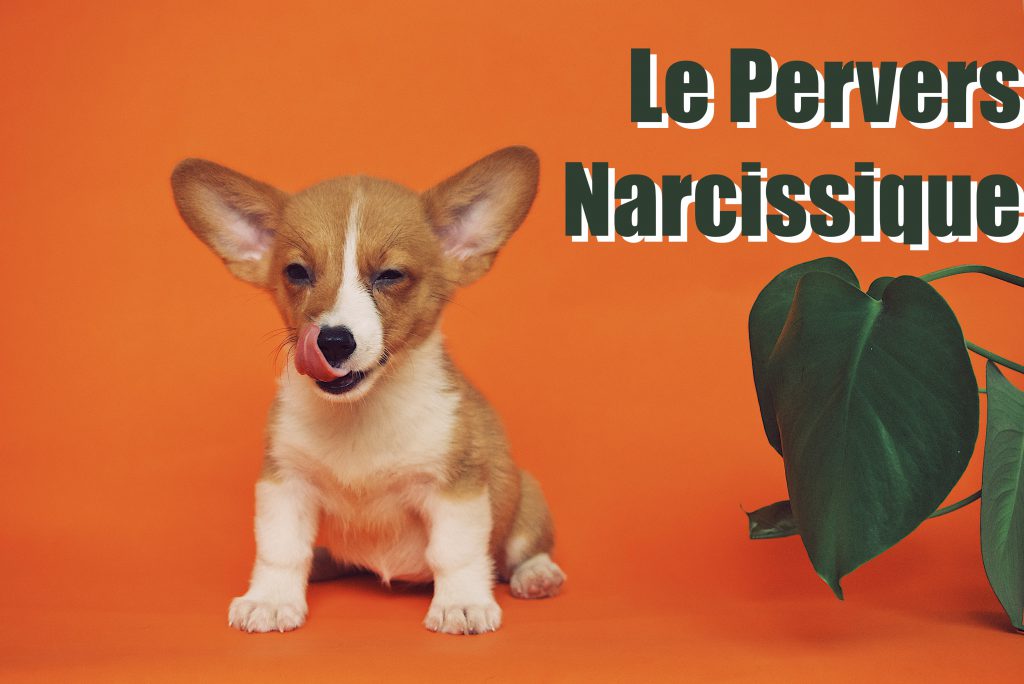
Pour bien comprendre ce que sont les pervers narcissiques et leur fonctionnement, je vous conseille de vous rendre en premier lieu sur l’article précédent qui explique les bases de la structure perverse. Dans cet article en trois parties, je vais vous expliquer quelles sont les spécificités cliniques et psychopathologiques du pervers Narcissique, nous étudierons un cas […]
La perversion

Sur cet article, vous allez trouver les bases qui vont être énoncées pour comprendre (dans un autre article) ce que sont les perversions narcissiques. Je vais tâcher de vulgariser au maximum ce concept mais c’est un sujet vraiment très, très complexe… Dans ce court article nous allons donc voir ce qu’est la perversion, quelles sont ses […]
L’attaque de panique (ou crise d’angoisse aiguë)
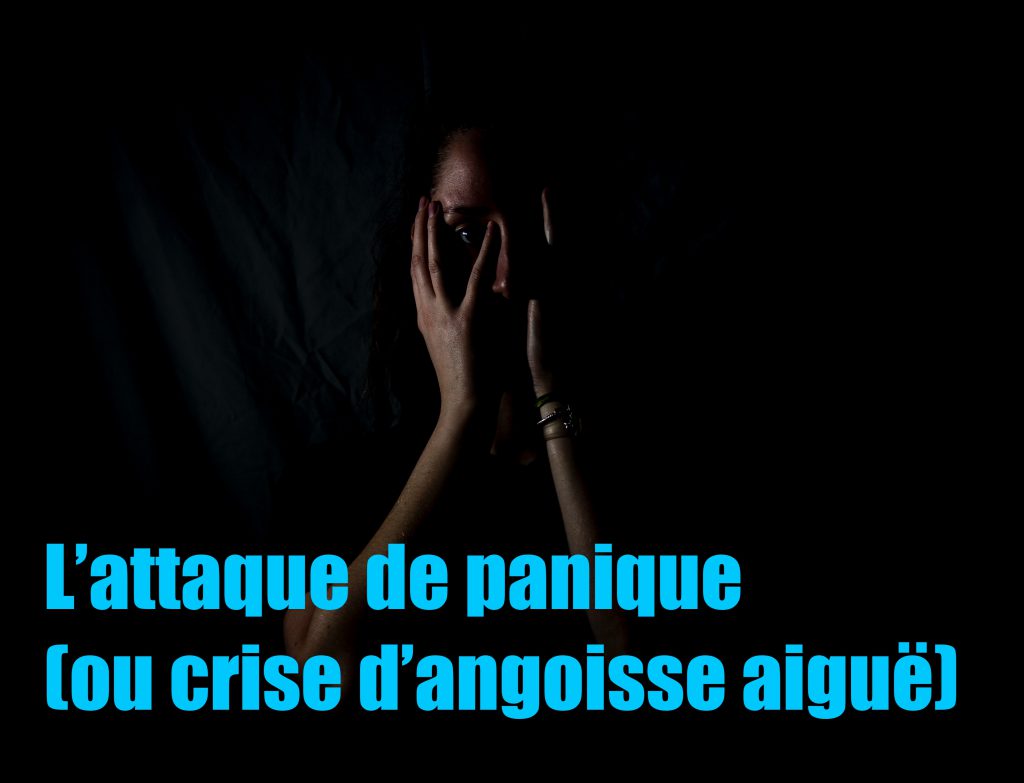
Une Attaque de Panique, c’est quoi ? Crise de tétanie, crise d’angoisse, crise de spasmophilie… Beaucoup de noms pour cette expérience qui ne peut clairement pas être traduite avec des mots et celles et ceux qui l’ont déjà vécu savent à quel point c’est vrai. Le DSM 5 tente quand même d’en dire quelque chose […]
Conseils en temps de confinement
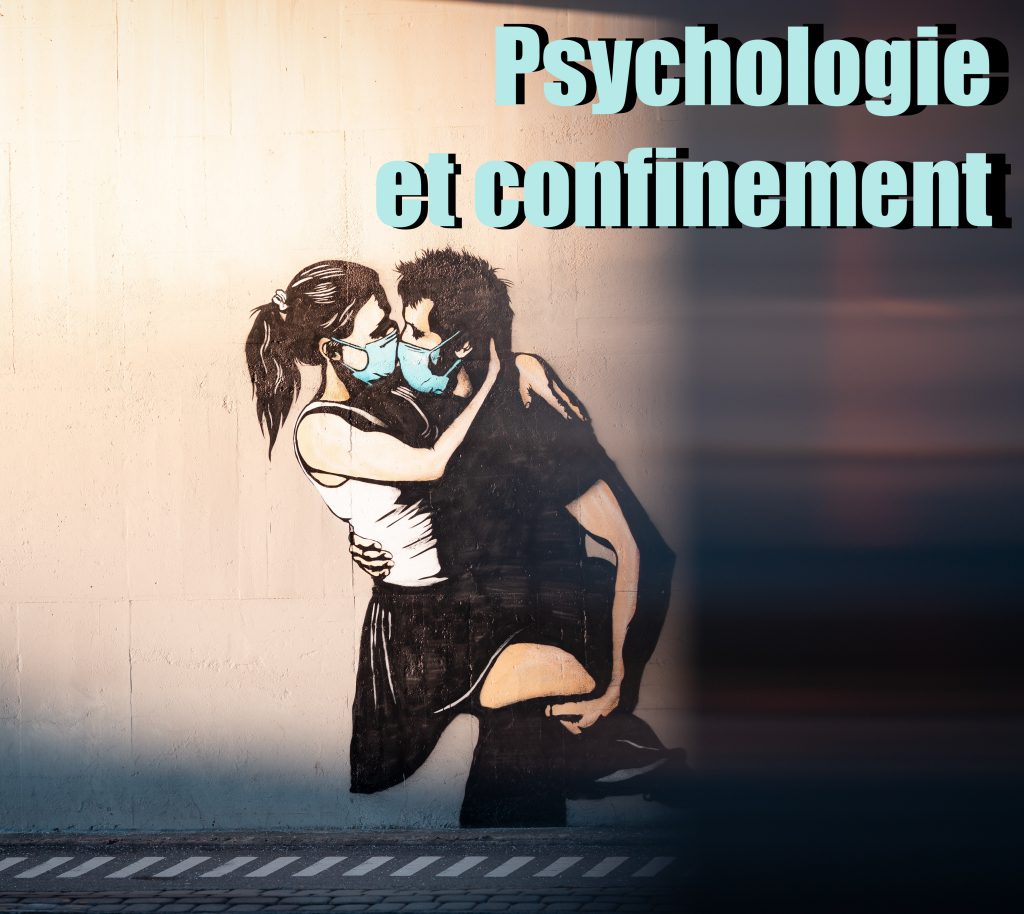
Photo : Daniel Tafjord Je vais ici tâcher de répondre à ce qui relève de mon domaine de psychologue clinicien en ce qui concerne les mesures non explicites de confinement qui ont court aujourd’hui en France pour cause d’épidémie (si ce n’est de pandémie) du coronavirus ou COVID-19. Quelles sont les conséquences psychologiques d’un tel enfermement […]
La dissonance cognitive
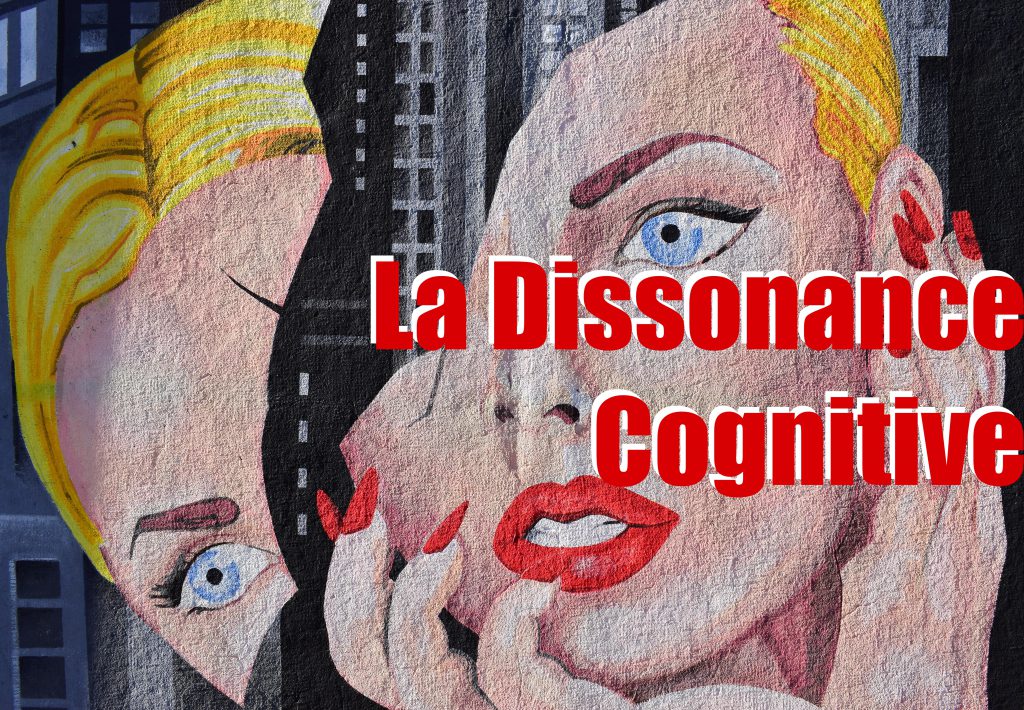
Qui n’a jamais eu le regret d’avoir effectué un comportement ou une action en contradiction avec ses principes et valeurs profondes ? Tout le monde ! Et souvent, une forme de culpabilité et d’incompréhension vont se présenter si l’on ne cherche pas trop inconsciemment à refouler cette action… Sinon, nous n’avons qu’à simplement changer nos […]
En quoi le concept de castration est pertinent ?
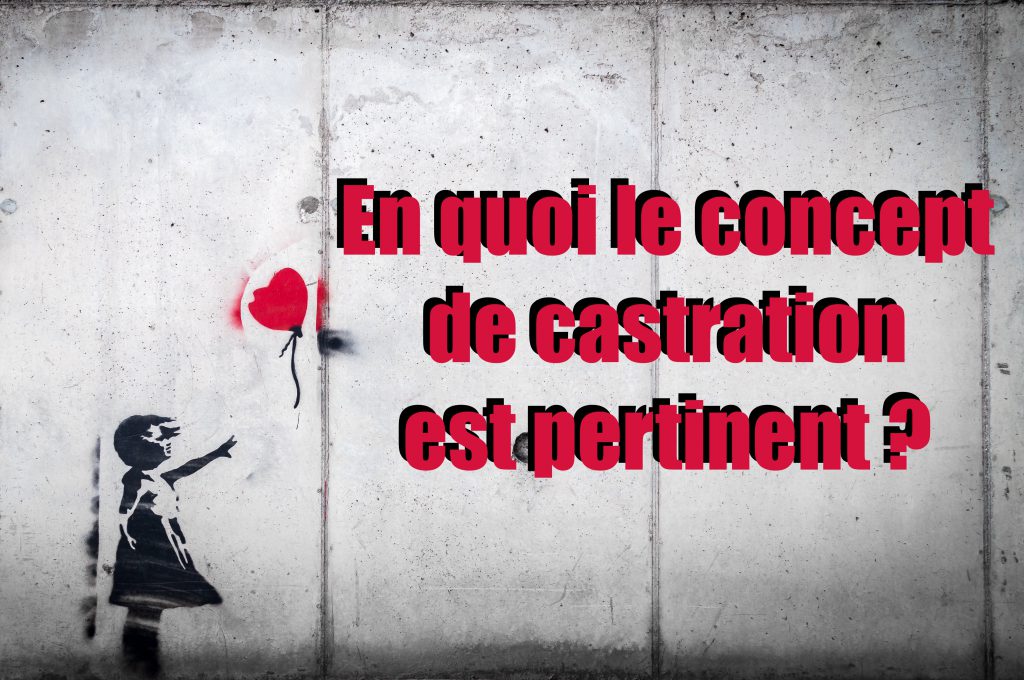
Pour ce qui est de comprendre ce qu’est le concept de castration dans les grandes lignes, de comprendre globalement ce qu’il signifie dans la pensée freudienne et lacanienne, je vous invite à regarder la vidéo que j’ai faite en collaboration avec Kevin de La Psychothèque autour du film « Edward aux mains d’argent » : Maintenant que vous […]
Qu’est-ce que le Complexe d’Oedipe ?

Le complexe d’Oedipe est selon moi une des plus belle découverte du fonctionnement psychique. Lorsque l’on comprend bien les conséquences que le complexe d’Oedipe implique sur la psyché d’un nourrisson et/ou d’un enfant il n’est pas étonnant de voir la résonance que ce concept – pourtant extrêmement décrié et attaqué par les nouvelles théories scientifiques […]